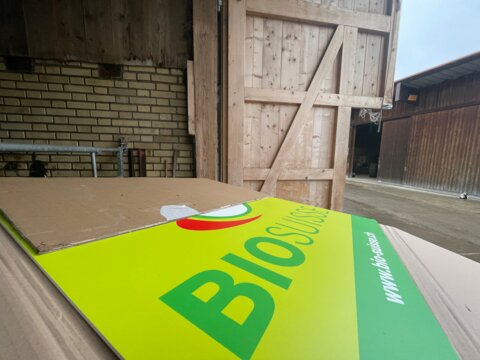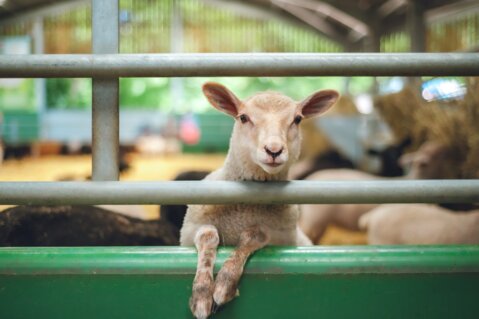SST obligatoire pour les poules pondeuses
Aujourd’hui déjà, la plupart des poules disposent d’un accès en plein air. Dès 2020, dans le cadre de Suisse Garantie, toutes les poules devront avoir accès à une aire à climat extérieur abritée. Cette règle s’applique également à l’élevage au sol. « Ainsi, les poules peuvent s’adonner quotidiennement à leur occupation préférée en plein air et gratter le sol comme bon leur semble », affirme le président de GalloSuisse Jean Ullmann, pour expliquer les avantages d’une aire à climat extérieur abritée. A l’étranger, les poules élevées au sol n’ont pratiquement jamais accès à l’air libre.
Les œufs sont commercialisés comme œufs provenant d’élevages au sol et sont vendus avec le numéro 2. Il s’agit des œufs les plus vendus sur le marché, avec une part de 35,5 % dans le commerce de détail, selon le secteur Observation du marché de l’OFAG.
Jardins d’hiver
L’aire à climat extérieur est couverte et ouverte sur les faces latérales à raison d’au moins 70 %. La majeure partie de la surface est recouverte de litière et abrite un bain à poussière. En hiver, une aire à climat extérieur abritée est une alternative judicieuse au pâturage lorsque ce dernier n’est pas accessible à cause de la météo. L’aire à climat extérieure étant une zone délimitée, les poules ont toujours accès à l’air libre, même lorsqu’elles doivent être confinées au poulailler à cause de la grippe aviaire.
GalloSuisse
Gestantes à l’alpage ?
Question Mes génisses partiront en estivage au mois de juin. Est-il judicieux qu’elles soient toutes gestantes au moment de monter à l’alpage ? Si tel est le cas, quelle est la stratégie la plus judicieuse ?
RéponseDès lors qu’une génisse a atteint le poids et l’âge nécessaire, il est peu judicieux, d’un point de vue économique, de ne pas l’inséminer avant qu’elle parte à l’alpage. En revanche, lorsqu’une génisse est encore trop peu développée ou trop jeune, je recommande d’attendre. Dans ce cas, le risque de vêlage difficile n’est pas négligeable, les organes de mise bas étant insuffisamment développés.
Contrôle de gestationIdéalement, les génisses inséminées avant la saison d’estivage devraient porter depuis plus de 60 jours lorsqu’elles montent à l’alpage. Ainsi, le risque d’avortement est moins important. Je conseille aussi d’effectuer les contrôles de gestation avant le départ à l’alpage. Vous saurez ainsi où en sont vos génisses, ce qui vous permettra de donner des instructions précises au garde-génisse qui s’en occupe. Cette façon de faire aide aussi à déceler les éventuels avortements à un stade plus précoce et à réagir en conséquence.
Quand inséminer:
Observation des chaleurs dès le mois de mars en consignant toutes les observations par écrit
Analyse gynécologique, par le vétérinaire de troupeau, des génisses qui ne sont pas venues en chaleur jusqu’au mois d’avril
Insémination de toutes les génisses jusqu’à la fin avril
Contrôle de fertilité au plus tôt 28 jours après l’insémination à l’aide de l’ultra-son.
Que faire des génisses qui ne portent pas:• Dans la mesure du possible, garder ces animaux sur l’exploitation de base pour mieux les observer • Informer le garde-génisse et se renseigner s’il est envisageable d’inséminer correctement les génisses pendant l’estivage.
Situation sur l’alpageL’observation des chaleurs se pratique de manière différente selon les alpages et selon qu’il est possible d’y faire inséminer des génisses. Le taureau reste-t-il avec le troupeau ? Quelles sont les chances qu’un animal gestant soit identifié et inséminé ?
Quels sont les inconvénients lorsque des génisses reviennent sur l’exploitation de base sans être gestantes ?
Coûts d’élevage et risque de réforme plus élevés
Animaux qui affichent un embonpoint excessif, ce qui se traduit par une dégradation de la fertilité et par un risque accru de maladie après le vêlage
Nécessité d’adapter la stratégie d’exploitation
Adapter la stratégieAprès le retour des génisses dans leur exploitation d’origine, il est également important de les faire contrôler directement, notamment quant aux maladies présentant un risque pour le troupeau de base (p. ex. la maladie du chamois et les dartres). A cette occasion, il faut aussi vérifier l’état corporel des animaux (p. ex. problèmes de vers) et effectuer un contrôle de gestation (vérifier que l’animal n’ait pas avorté). Rensei-gnez-vous auprès de votre vétérinaire pour définir une stratégie optimale.
Une question vous préoccupe et vous souhaitez la poser à un vétérinaire?
Envoyez-nous alors votre question par poste ou par e-mail:Revue UFA, Theaterstrasse 15a, 8401 Winterthour, info@ufarevue.ch
Âge et poids des génisses
L’âge au premier vêlage recommandé est souvent de 24 mois, ce qui implique d’inséminer les génisses dès l’âge de 15 mois. Le poids à la première insémination joue également un rôle: les génisses devraient alors peser environ 450 kg (PV). Selon les races et les structures d’exploitation, il est également possible de repousser légèrement (p. ex. 26 mois) l’âge au premier vêlage. Lorsqu’on insémine des génisses après la saison d’alpage ou après la mise à l’étable, il s’ensuit une perte de temps et d’argent (performance laitière inférieure, coûts d’élevage plus élevés, risques d’élimination précoce en ce qui concerne les génisses affichant un embonpoint excessif, etc.). Chez les génisses, une bonne fertilité se reflète dans un faible indice d’insémination de 1,3 insémination par gestation (exprimé différemment, cela revient à dire que trois génisses sur dix doivent être inséminées une seconde fois).