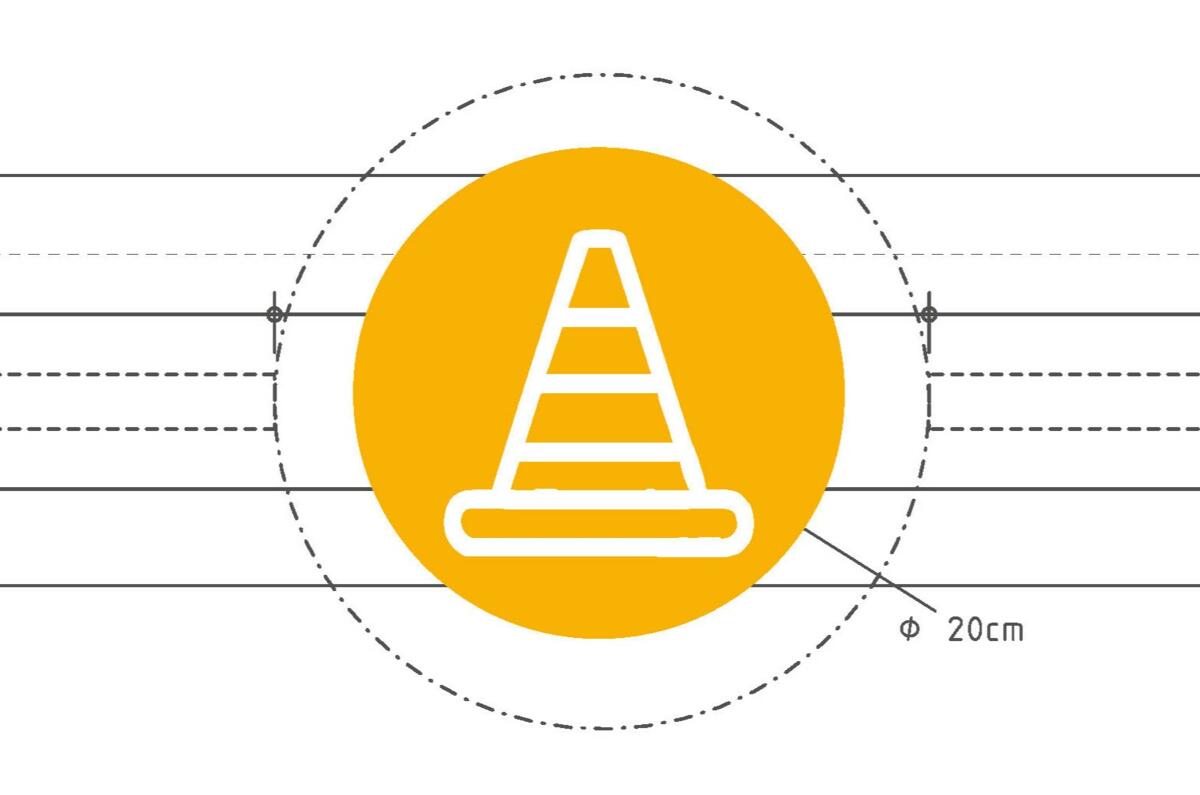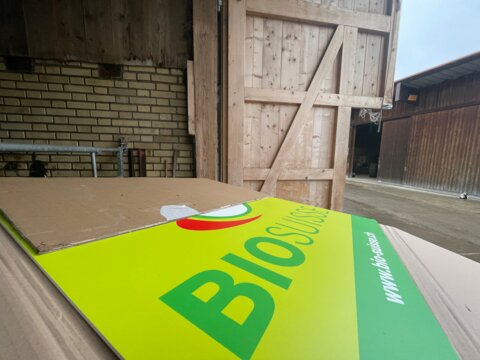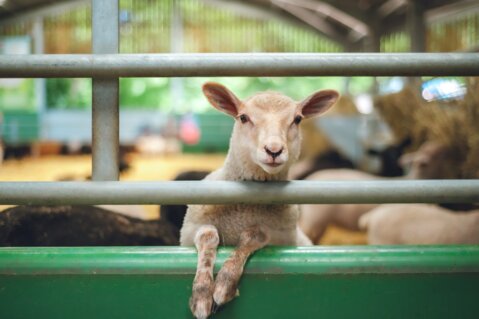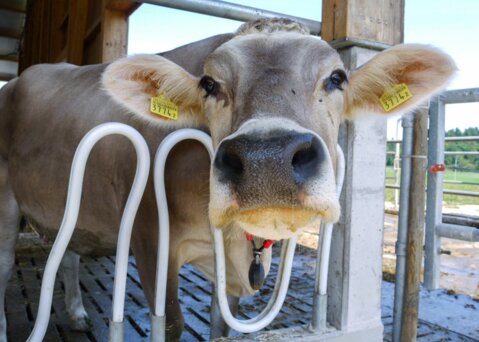Immissions
Question : Quelles sont les distances minimales à respecter pour de nouveaux sites dédiés à la production animale ?
Réponse :La tolérance des riverain·es face aux nuisances sonores et olfactives ne cessant de diminuer, il est nécessaire d’effectuer en amont des clarifications approfondies. Les distances minimales à respecter entre exploitations gardant des animaux et les habitations voisines (ou autres zones sensibles) peuvent être déterminées de manière préventive au moyen du « calcul des distances minimales à respecter par les installations d’élevage », sachant que ce dernier est en cours de révision. A noter que les cantons appliquent des bases de calcul différentes, car il n’existe, de la part de la Confédération, ni modèle de calcul ni aide à l’exécution correspondant aux derniers fondements scientifiques et techniques élaborés par Agroscope.
En plus des distances liées aux immissions d’odeurs, il faut tenir compte des valeurs limites d’immission pour l’ammoniac par rapport aux zones de protection (p. ex. forêts, zones humides ou sèches). Elles constituent en effet un critère d’exclusion si elles sont dépassées. Si, sur un site existant, les distances nécessaires au respect de ces seuils (charge critique et niveau critique) ne peuvent être garanties, des dérogations peuvent être accordées à condition que toutes les mesures de construction visant à protéger l’environnement aient été mises en œuvre.
Pièges / obstacles
Quels sont les écueils à éviter lors du choix d’un site approprié ?
Pour choisir un site, il faut d’abord vérifier si des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, comme la présence des éléments suivants : zone ou autre entité de protection (paysage, zones ou secteurs de protection des eaux, marais, monuments classés, etc.), espaces réservés aux eaux (y c. cours d’eau canalisés), corridor à faune, ou forêts (distance par rapport à ces dernières) ; si tel est le cas, alors le projet ne peut pas être réalisé. L’étude du projet d’exécution doit aussi intégrer les distances par rapport aux routes publiques et veiller au respect des zones de visibilité des aires d’accès de l’exploitation.
Il convient également de vérifier la présence éventuelle des éléments suivants : sites contaminés, vestiges archéologiques, sentiers pédestres, pistes cyclables, anciens chemins de communication historiques, dangers naturels ou liés au ruissellement de surface (carte de l’aléa ruissellement). Ces informations sont disponibles sur les géoportails cantonaux ou sur le géoportail fédéral (cf. codes QR).
Dans les exploitations agricoles, il apparaît régulièrement que certains bâtiments, surfaces ou utilisations n’ont pas fait l’objet d’une autorisation. Ces situations d’irrégularité compliquent les négociations avec les autorités. En effet, ces dernières exigent aujourd’hui souvent que ces situations soient régularisées avant tout nouvel examen de demande de permis de construire. C’est l’un des principaux écueils dans la procédure de demande. Voir à ce sujet « Construction illégale » (Revue UFA 3 / 2020, pp. 8 - 10.)
Viabilisation
Quelles exigences s’appliquent en matière de viabilisation lors de projets de construction en agriculture ?
La viabilisation comprend les travaux de raccordement aux réseaux de distribution (eau, eaux usées, électricité et Internet). Les discussions portent souvent sur le type de revêtement à choisir pour la voie d’accès à la ferme. L’exigence d’un revêtement adapté aux camions pose moins de problème que celle d’un revêtement sans poussière. Pour justifier son choix en la matière, il est possible de se référer à la circulaire 2023 / 01 de l’OFAG intitulée « Principes régissant le subventionnement des chemins agricoles » (8 mai 2023, actualisée le 3 avril 2025). Par ailleurs, pour les accès longs ou à visibilité réduite, il convient de prévoir des places d’évitement.
Délimitation exploitations à titre professionnel / à titre de loisir
Exploitations à titre professionnel et à titre de loisir : quelles différences ?
Un domaine agricole ayant droit aux paiements directs est considéré, au regard du droit de l’aménagement du territoire, comme « exploitation agricole » (activité accessoire) tant qu’il n’a pas dépassé le seuil défini pour constituer une « entreprise agricole ». Il peut, au titre de la conformité à l’affectation de la zone, réaliser les constructions et installations nécessaires, pour autant que l’existence d’une entreprise agricole ne soit pas exigée comme condition préalable à l’autorisation. Les exploitations non bénéficiaires de paiements directs (moins de 0,2 unité de main-d’œuvre standard) relèvent de l’agriculture pratiquée en tant que loisir. Dans le cadre de l’art. 24e LAT et de l’art. 42b OAT, elles peuvent garder des animaux à titre de loisir.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Une comptabilisation volontaire de la TVA vaut-elle la peine pour un projet de construction ?
Une déduction de l’impôt préalable est possible si l’exploitation agricole s’inscrit volontairement à la TVA et reverse cette dernière sur son chiffre d’affaires. Les subventions et contributions réduisent le droit à la déduction de cet impôt. Ainsi, pour évaluer la pertinence de cette option, il est nécessaire d’effectuer des calculs, cette dernière dépendant fortement de la situation propre à chaque cas.
Maître d’ouvrage comme employeur
Puis-je engager et assurer moi-même des aides de chantier à travers mon exploitation agricole pour un projet de construction ?
Une exploitation agricole construisant pour ses propres besoins (logement, grange, etc.) n’est pas soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction (CN). Seuls les employé·es d’entreprises employeuses dont l’activité principale relève du gros œuvre y sont assujettis.
Si les travaux servent à des fins d’exploitation (bâtiments ruraux), les employé·es, même engagés exclusivement pour le chantier, peuvent être assurés contre les accidents moyennant une assurance globale.
Cependant, en vertu de la législation, les bâtiments d’habitation – ce qui inclut explicitement le logement de l’exploitant·e – sont considérés comme privés. Dès lors, si, sans tenir compte de la participation de l’exploitant·e, les travaux nécessitent au moins 500 heures de travail, les aides doivent obligatoirement être assurées contre les accidents auprès de la SUVA (cf. art. 66, al. 2, let. d, LAA, en conjonction avec l’art. 89 OLAA).
Loi sur l’aménagement du territoire (LAT)
Quand entreront en vigueur les modifications liées à la deuxième étape de la révision de LAT ?
Le Parlement fédéral a adopté la deuxième étape de révision de la LAT, sans qu’un référendum ne soit lancé. La version révisée de l’ordonnance correspondante (ordonnance sur l’aménagement du territoire, OAT) sera adaptée après la procédure de consultation.
Actuellement, il est prévu que la loi et l’ordonnance entrent en vigueur durant le premier semestre de 2026, par décision du Conseil fédéral. Pour en savoir plus à ce sujet, se référer à l’article « Plus de clarté pour les constructions à la campagne » de la Revue UFA 11 / 2024.
Conseil de l’expert
Existe-t-il un conseil ultime pour réussir un projet de construction ?
Un projet bien motivé, bien planifié et accompagné de tous les documents requis est déjà à moitié gagné. Les autorités compétentes en matière de construction peuvent accomplir beaucoup, mais elles ne possèdent pas le don de lire dans les pensées. Une description écrite du projet, accompagnée d’indications sur les matériaux envisagés ainsi que sur les réflexions concernant l’exécution et le choix du site, rend un projet beaucoup plus compréhensible et crédible. Le dépôt d’une demande de permis de construire ne relève pas du hasard, mais constitue une démarche réfléchie et planifiée pour développer l’exploitation.
Auteurs
Hansueli Schaub Responsable Aménagement du territoire, Agriexpert; Xaver Hunziker Responsable suppléant du secteur Fiduciaire, Agriexpert; Stefan Binder Conseiller, Agrisano