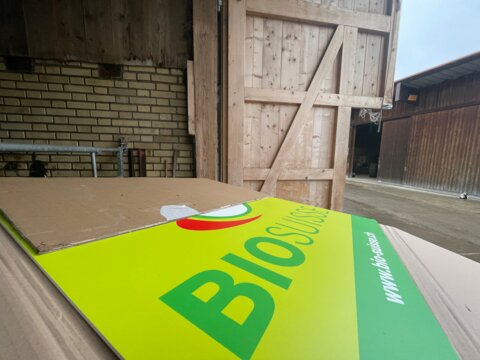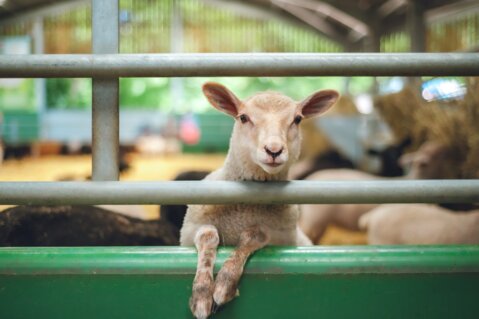La rentabilité de la production laitière repose en grande partie sur l’efficience alimentaire, qui désigne la capacité de la vache à convertir la quantité d’aliments ingérés en lait. Plusieurs facteurs influencent ce paramètre : parmi les plus importants figurent la race, les conditions climatiques, la gestion de l’alimentation et de la traite, la santé du troupeau et la composition de la ration. En particulier, le rapport entre l’énergie et les protéines dans la ration joue un rôle clé dans l’optimisation de cette conversion.
En bref
- En dessous de 135 g PB/kg MS dans la ration totale (teneurs moyennes), les performances diminuent.
- Un apport en protéines trop élevé peut avoir des effets négatifs sur le métabolisme, la fécondité et l’environnement.
- Selon le niveau de production laitière, la teneur optimale en PB de la ration totale va de 145 g et 165 g par kg de MS.
Ajuster l’apport en protéines
Un apport protéique inadapté a des conséquences négatives : un approvisionnement insuffisant ne se manifeste pas uniquement par des taux d’urée faibles, il réduit aussi la consommation de MS et limite la capacité des micro-organismes de la panse à exprimer pleinement leur potentiel. Ces deux facteurs combinés péjorent la production laitière, comme l’ont démontré plusieurs études. En particulier, une étude menée aux Pays-Bas, où l’approvisionnement en azote est très strictement limité, montre qu’en dessous de 135 g PB / kg MS dans la ration totale (teneur moyenne en PB), l’ingestion de MS diminue de manière significative, réduisant la production laitière et se traduisant par une faible teneur en urée (dans l’étude, 9 mg / dl). De plus, un apport en protéines insuffisant réduit la digestibilité des fibres, ce qui compromet l’approvisionnement en énergie. Or la digestion des fibres joue un rôle crucial, notamment dans les rations suisses. En effet, plus les fibres sont digérées de manière efficiente, mieux le fourrage de base est valorisé. A son tour, cette meilleure valorisation du fourrage de base accroît l’efficience alimentaire. Cela optimise ainsi l’apport énergétique et accroît la production laitière.
Un apport ciblé en protéines garantit la performance ainsi que la santé.
Si les exploitations sont nettement mieux sensibilisées à l’importance d’un apport protéique adapté, il en reste qui disposent encore d’un potentiel de réduction, en particulier, celles qui recourent à des systèmes d’alimentation basés sur la pâture. En effet, ceux-ci induisent parfois des teneurs en urée très élevées pendant les mois d’automne. Or un approvisionnement excessif en protéines est non seulement problématique pour l’environnement, mais peut aussi avoir des effets négatifs sur la santé des animaux : le foie est inutilement sollicité, l’excès d’ammoniac provenant de la panse devant être transformé en urée. De plus, il est prouvé que des taux élevés d’urée dans le métabolisme sont fœtotoxiques (c.-à-d. qu’ils peuvent causer la mort de l’embryon). La fécondité s’en trouve ainsi aussi compromise.
Modèles pour l’avenir
L’équilibre optimal entre protéines et énergie dans la ration améliore assurément l’efficience de l’azote ainsi que l’efficience alimentaire, tout en soutenant la santé et les performances des animaux et en préservant le climat. Un apport protéique efficient nécessite plus que la simple optimisation de la teneur en PB de la ration : il s’agit aussi de considérer la part de protéines rapidement fermentescibles et vraiment disponibles dans l’intestin, qui contribuent à augmenter l’efficience protéique. Quant aux paramètres éprouvés (p. ex. système des protéines absorbables dans l’intestin [PAI]), ils sont de plus en plus remis en question, car leur précision est moindre par rapport aux paramètres cités. De plus, recourir à des composants appropriés permet de réduire la teneur en protéines de la ration totale sans conséquences négatives. En particulier, l’utilisation d’acides aminés protégés dans la panse est une option qui gagne en importance. Comme ces acides, qui sont essentiellement le produit de la dégradation des protéines, sont directement incorporés dans l’alimentation, la teneur en PB de la ration totale peut être réduite jusqu’à 145 g PB / kg MS sans baisse de la production laitière. Selon le niveau de production, la teneur optimale en PB de la ration totale se situe entre 145 g et 165 g par kg de MS.
De combien de protéines les vaches laitières à haut rendement ont-elles réellement besoin ?
Les vaches laitières à haute productivité peuvent-elles produire autant de lait de manière aussi rentable avec un apport minimal en protéines (teneur en urée inférieure à 10 mg / dl) que les vaches approvisionnées en protéines selon la pratique courante (urée 15 - 25 mg / dl) ?
Pour répondre à cette question, un essai alimentaire de 4 mois a été mené à la ferme expérimentale « Swiss Future Farm » de Tänikon. Le troupeau a été divisé en deux groupes : le premier (« ration pauvre en protéines ») devait atteindre une teneur en urée dans le lait inférieure à 10 mg / dl ; le deuxième (« ration W-FOS ») a reçu une ration optimisée selon les recommandations W-FOS, telle qu’elle est aussi mise en œuvre dans d’autres exploitations.
Les deux rations étaient établies sur la même ration de base, composée de 42 % d’ensilage de maïs, 38 % d’ensilage d’herbe, 5 % de fourrage sec et 5 % de pulpe de betterave sucrière. La ration pauvre en protéines était quant à elle complétée par 1,5 kg de mélange de céréales et un additif ad hoc pour améliorer l’efficience protéique ; la ration « W-FOS » était pour sa part complétée par 1,5 kg de concentré protéique.
Les deux groupes ont été alimentés pendant deux mois avec leur ration respective, puis les rations ont été échangées et l’essai s’est poursuivi pendant deux mois de plus. Des pesées du lait ont été réalisées toutes les deux semaines. De plus, l’ingestion de fourrage de base et d’aliments concentrés a été saisie avec les données de la mélangeuse et du robot de traite afin de calculer les coûts alimentaires par kg de lait.
Urée faible, production faible
L’essai mené à la Swiss Future Farm montre clairement ceci : les vaches à haute productivité dont la teneur en urée du lait est inférieure à 10 mg / dl produisent non seulement moins de lait et un lait moins riche en protéines, mais présentent aussi une ingestion réduite. Suite au passage à la ration W-FOS, la production a crû de 7 kg par vache et par jour, dont 4 kg de plus d’ECM (lait corrigé en énergie) en moyenne sur tout l’essai. Des différences sont aussi apparues dans les constituants du lait : avec la ration pauvre en protéines, les taux protéiques ont reculé, tandis qu’ils avaient tendance à croître avec la ration W-FOS. Fait marquant : avec celle-ci, l’ingestion de MS était constamment plus élevée (+ 2 kg MS par vache et par jour en moyenne sur l’ensemble de l’essai), alors même que les coûts alimentaires par kg de lait étaient inférieurs de 3 ct. grâce à la production plus élevée.
En revanche, les vaches recevant la ration pauvre en protéines présentaient des signes de carence (p. ex. léchage d’urine). De plus, le rinçage à l’eau des fèces a révélé une moins bonne valorisation alimentaire. En conclusion, un complément protéique ciblé s’avère nécessaire et judicieux pour assurer non seulement la rentabilité, mais aussi le bien-être animal.