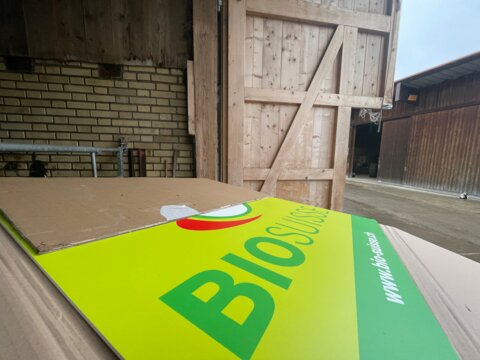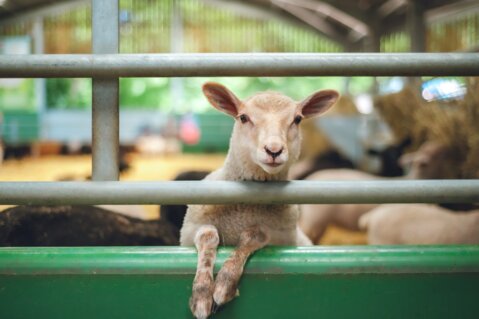Jadis, dans le val Poschiavo (GR), les châtaigniers étaient une ressource vitale pour nombre de familles. La prospérité croissante de la région a fait tomber ces fruits dans l’oubli… jusqu’à il y a une trentaine d’années, quand les propriétaires des arbres ont décidé de sauver et entretenir les châtaigneraies. C’est de là qu’est née la Sagra della Castagna (fête de la châtaigne), devenue la Settimana della Castagna (semaine de la châtaigne en 2020).
Fête et tradition
Dans le val Poschiavo, pendant la settimana della Castagna, ce sont les marunatde Brusio qui font griller les marrons chauds (braschéen dialecte) dans le chaudron. Armés d’une pelle en fer blanc, ils les distribuent encore fumants gratuitement dans des sachets en papier. Issue des bosquets locaux, la variété utilisée est indigène du Piémont. Piero Pola, expert en la matière précise : « On ne la trouve ici qu’en petites quantités ».
Les propriétaires font découvrir leurs châtaigneraies. C’est le cas de Piero Pola et de son neveu Luca qui offrent des visites depuis 2020 à Campocologno, à la frontière italienne. « Le village compte 500 châtaigniers appartenant à 30 familles. Personne d’autre n’est autorisé à en récolter les fruits », note Piero. Cette passion le pousse chaque année à mettre sur pause son travail d’assistant de direction au Centro sanitario Valposchiavopour ramasser les fameux fruits et organiser la semaine de la châtaigne.
Enfant déjà, dans les années 1970, Piero Pola faisait griller des marrons en famille dans une poêle spéciale, ou en faisait de la soupe ou de la confiture. Ce passionné possède et entretient aujourd’hui une trentaine de châtaigniers, tous sis sur une parcelle de la corporation de Campocologno et Zalende. Bizarrerie locale : bien que sur un terrain public, les arbres appartiennent à ceux qui les ont plantés. Ce système relève du jus plantandi(une ancienne loi). « Il s’agit plutôt d’une coutume, qui visait à répondre à deux problématiques : préserver des terrains publics pour faire paître les animaux et permettre aux particuliers de produire des châtaignes », précise Marco Conedera, ingénieur forestier à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL de Cadenazzo (TI).
Fête de la chataîgne
La quatrième édition de la semaine de la châtaigne aura lieu du 4 au 12 octobre 2025 et s’achèvera en apothéose avec la « Sagra della castagna ». Cette fête, organisée par l’association Società castanicoltori di Brusio, aura lieu au centre sportif Casai, non loin de Brusio. Parmi les 4000 châtaigniers de la commune, près de la moitié sont exploités pour leurs fruits. En 2024, la fête a attiré 650 personnes et 320 kg de châtaignes ont été distribués gratuitement. C’est l’occasion aussi d’observer la cuisson au charbon de bois, qui demande un réel savoir-faire. « Les châtaignes ne doivent pas brûler, sinon elles deviennent immangeables », avertissent Daniela et Gianni Zanolari, propriétaires de châtaigniers venus de Zalende. « Mieux vaut les faire griller lentement et les retourner souvent. »
Jadis un aliment incontournable
Il y a 100 ans, une famille de six personnes consommait jusqu’à 900 kg de châtaignes par an. En 1991, le Fonds suisse pour le paysage a débloqué une enveloppe pour sauver les châtaigneraies. « Une fois classées, ces parcelles restaurées ont pu bénéficier de subventions, qui ont servi à financer à 70 % les mesures de préservation », rapporte Piero. De plus, dans le cadre d’Interreg III, l’UE a versé 203 000 euros aux communes de Tirano et de Brusio entre 2000 et 2006, tandis que la Confédération a financé la participation suisse aux programmes Interreg. A cela s’ajoutent les contributions à la biodiversité octroyées par la Confédération et le canton.
Nonobstant, plusieurs maladies ou parasites ont sévi ces dernières années (chancre de l’écorce du châtaignier, maladie de l’encre ou encore, cynips du châtaignier), compromettant la survie des peuplements. Fort heureusement, la lutte biologique et les auxiliaires naturels ont permis aux forêts de se régénérer en partie. Cette gestion écoresponsable explique pourquoi, comme le souligne Piero, toutes les châtaignes sont par définition biologiques : elles poussent librement en forêt. Des arbres bien entretenus peuvent vivre très longtemps : à Brusio, il existe des spécimens âgés d’environ 150 ans, tandis qu’au Tessin ou dans le val Mesolcina, on trouve des arbres qui atteignent entre 300 et presque 500 ans.
En dehors de la récolte, entre fin septembre et octobre, il convient de tondre l’herbe, enlever les feuilles et les pousses, tailler les branches ou encore réparer les murs de pierres sèches.
Aux dires de Piero Pola, il arrive qu’il y ait de petits larcins malgré les panneaux indiquant clairement que ces arbres sont des propriétés privées. « Cependant, il ne s’agit jamais de grandes quantités », tempère ce passionné de châtaignes. Cette tolérance découle historiquement d’une volonté : celle de ne pas assimiler des personnes dans le besoin à des bandits sans foi ni loi. Aujourd’hui, des projets comme « Frutti per tutti » autorisent la cueillette dans certaines zones.
Des fruits fragiles
Le châtaignier (Castanea sativaMill.) a des fruits très fragiles, qui se périment rapidement à cause du dessèchement, des moisissures ou des insectes. Notons que le marronnier, qui bordait autrefois nombre de routes et chemins suisses, n’a aucun lien de parenté avec le châtaignier, même si on les confond souvent
Depuis toujours, les humains apprécient le châtaignier pour sa polyvalence : ils se sont installés là où il poussait et l’emportaient avec eux quand ils migraient. Son bois servait notamment de piquets pour les ceps de vignes, qui accompagnaient aussi l’humain dans ses pérégrinations.
« En Suisse italienne, on dénombre encore une cinquantaine de variétés de châtaigniers, dont une demi-douzaine dans la commune de Brusio, indique Piero Pola. Trois ou quatre d’entre elles sortent du lot : Tempurivi, Tudisci, Marroni dei Pirenei et Marun. J’ai moi-même toutes ces variétés », dit-il fièrement.
L’avenir du châtaignier
En 2025, une récolte abondante est attendue au val Poschiavo : celle-ci pourrait s’élever à environ 2000 kg. Les restaurants de la vallée ne manqueront donc pas de proposer des menus à base de marrons pendant la semaine de la châtaigne. La question de la relève se pose néanmoins. Jusqu’à présent, les particuliers livraient, dans les bonnes années jusqu’à deux tonnes par automne au centre collecteur de Campascio. Les spécialistes voient cependant un potentiel bien plus grand, comme l’explique Piero Pola : « L’avenir dépend de la volonté des jeunes de poursuivre la tradition – et du climat. »
Paiements directs pour les châtaigneraies grisonnes
Les châtaigneraies sont classées en deux catégories : culture pérenne (code 0720) et comme prairie de fauche (0411). Dans les Grisons, les cultures pérennes regroupent 35 hectares, soit un millier d’arbres, surtout utilisés pour le pâturage. Chaque hectare bénéficie de 2700 à 3600 francs de paiements directs tandis que la subvention par arbre s’élève à 13 fr. 50.
Quant aux châtaigneraies utilisées comme prairies de fauche, elles font partie des surfaces extensives, les chiffres ne sont donc que des approximations. On estime à 30 hectares la surface concernée. Les contributions, incluant les contributions à la promotion de la biodiversité, y sont équivalentes, voire légèrement supérieures (3500 à 4500 francs par hectare). Quant à la subvention par arbre, elle s’élève à 36 fr. 50.
En revanche, les nouvelles plantations ne reçoivent aucune aide.
Source : Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (service de l’agriculture et de la géoinformation), Coire