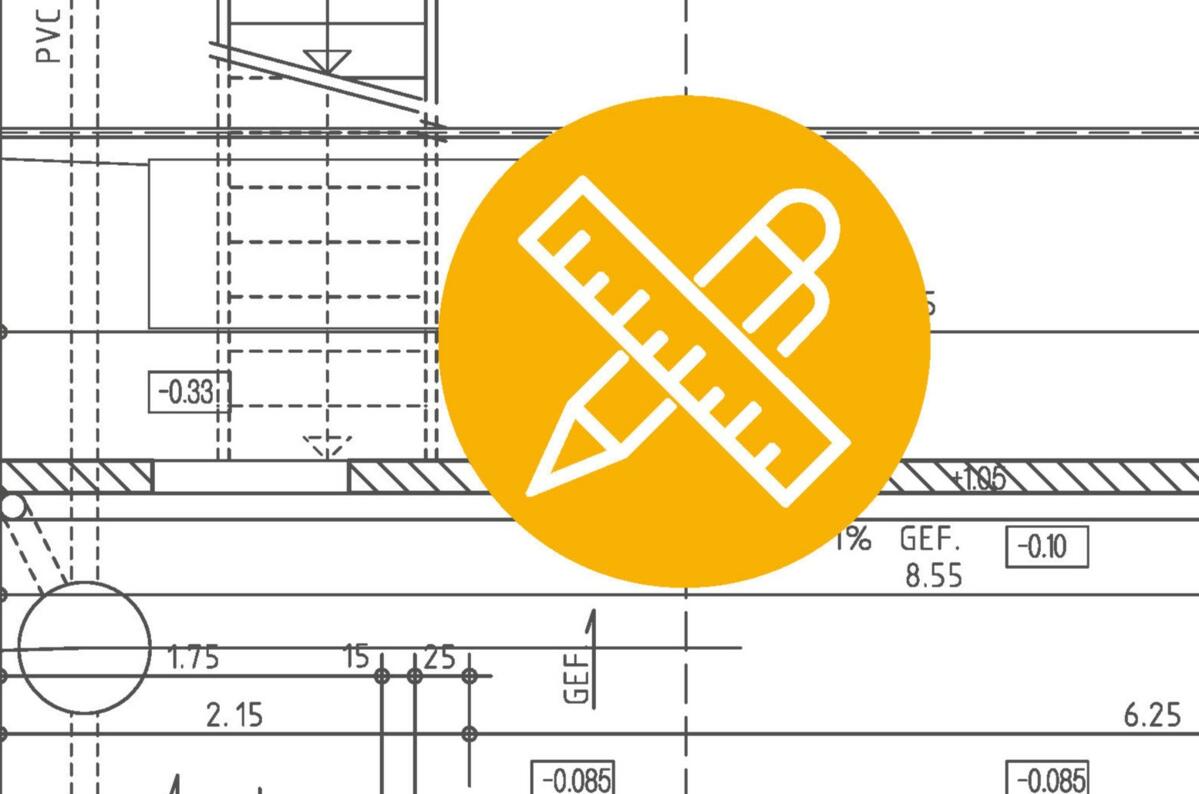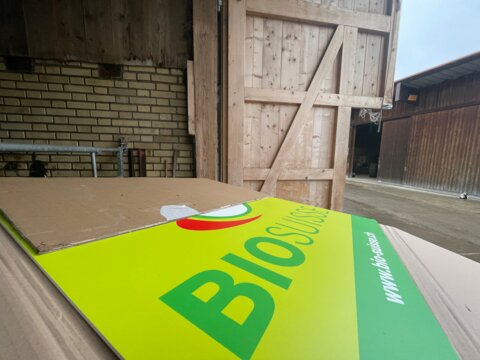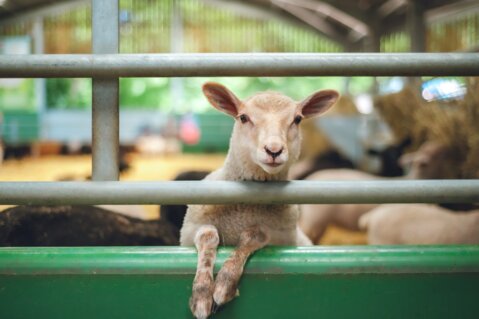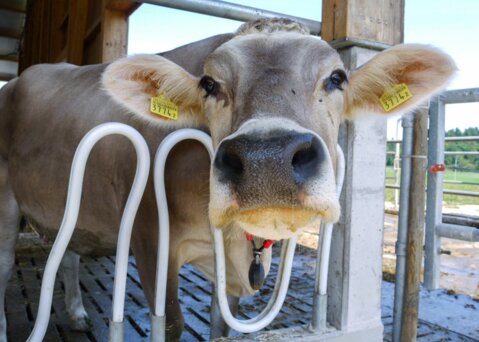Financement et cadre budgétaire
Avant de commencer la planification proprement dite, il est nécessaire de définir le cadre budgétaire en se renseignant sur le financement possible (charge maximale admise, c.-à-d. plafond légal d’endettement hypothécaire) et en fixant la marge de manœuvre financière sur la base de la comptabilité. Il s’agit ensuite de planifier les différents processus d’exploitation en prenant en compte les dispositions en matière de protection des animaux et en se référant aux fiches de construction ART.
Planifier l’aménagement au préalable
Une fois les travaux liés aux équipements de l’exploitation attribués, il est possible de déterminer le produit utilisé dans l’étable et le degré de mécanisation en fonction du budget, des éléments qui conditionnent de nombreux détails et composants. En effet, si l’installation d’un robot ou d’une salle de traite influence la planification, celle d’un brasseur a, quant à elle, une incidence sur la forme et la position de la fosse à purin. Ce processus peut certes prendre un certain temps, mais il en vaut la peine pour maintenir les coûts à un faible niveau lors de la planification des travaux.
Une fois le montant des travaux connu (charge maximale, plan de financement), les entreprises concernées peuvent développer le projet en collaboration avec l’agriculteur·trice et l’architecte.
Autres spécialistes impliqué·es
Il faut tenir compte des honoraires du bureau d’études, qui s’ajoutent à ceux de l’architecte. Ce type de bureau est chargé d’établir des documents et rapports détaillés ainsi que, dans certains cantons, de créer des visualisations des bâtiments et de l’aménagement des environs. Il s’agit de tâches spécifiques, qui deviennent de plus en plus exigeantes.
Les agriculteurs·trices n’étant pas toujours en mesure de répondre directement aux questions posées sur les différents sujets concernés, il y a lieu de rassembler certains documents ou de les demander auprès des autorités compétentes. Il s’agit notamment des distances à respecter pour éviter les émissions d’odeurs ainsi que des directives en matière de protection des sols et d’intégration dans le paysage.
Compétences et direction des travaux
Même si ce point suscite régulièrement des discussions, il reste essentiel, car il peut permettre à l’agriculteur·trice de réaliser des économies, notamment par sa participation à la direction des travaux (suivi de l’avancement du chantier et coordination des interventions des entreprises). Ainsi, il est essentiel que l’architecte puisse compter sur l’agriculteur·trice comme relais sur le chantier. L’organisation et la coordination des travaux doivent être définies dans un programme par les artisans et l’agriculteur·trice. Cependant, avant de commencer la direction des travaux, il faut d’abord réaliser l’appel d’offres et les attributions, une étape clé. Avant le démarrage effectif des travaux, 80 % de ceux-ci devraient avoir été attribués. Un contrat d’entreprise devrait également avoir été établi avec les différents artisans.
Validation, contrôles et réclamations
Après l’obtention du permis de construire, il faut demander à la commune l’autorisation de commencer les travaux, ce qui peut s’avérer plus ou moins contraignant selon les cas. Après réception de l’autorisation écrite indiquant que les travaux peuvent débuter, il convient de planifier une ou plusieurs réunions avec toutes les personnes concernées : agriculteur·trice, entrepreneur·e et architecte, voire aussi ingénieur·e spécialisé·e. Après l’achèvement des travaux par l’entrepreneur·e, ceux-ci doivent être contrôlés, en vue de consigner les éventuels défauts par écrit et de les signaler dans les délais.
A ce moment-là, la question se pose de savoir qui est responsable de l’établissement et de la remise des procès-verbaux de réception ou des plans de révision. Cette responsabilité doit être attribuée à l’avance, car elle a également une incidence en matière de responsabilité civile : si rien n’est clairement défini, c’est habituellement le maître d’ouvrage qui est responsable en cas de dommage. La construction et le mandat d’architecte constituent donc une affaire de confiance. Ce n’est qu’après la réception finale que la construction est considérée comme achevée.
Participation de l’agriculteur·trice
Avant même d’entamer la planification proprement dite, l’agriculteur·trice doit avoir une idée claire de ses objectifs et de ses attentes. Connaître ses besoins et évaluer de manière réaliste le rapport coûts / bénéfices peut contribuer de manière décisive à la réussite du projet. Des questions telles que « Comment est-ce que je vois mon avenir ? », « Quelles stratégies d’exploitation est-ce que je souhaite adopter ? » ou « Quels sont mes objectifs à long terme ? » font partie de la préparation stratégique.
L’agriculteur·trice peut également participer activement à la phase de construction, par exemple lors du montage des équipements de l’étable. Le potentiel d’économies est le plus important lorsque des étapes de travail entières peuvent être prises en charge par l’agriculteur·trice.