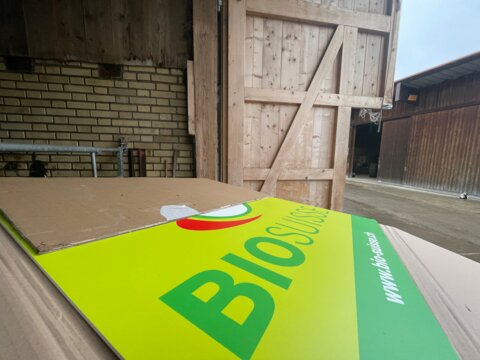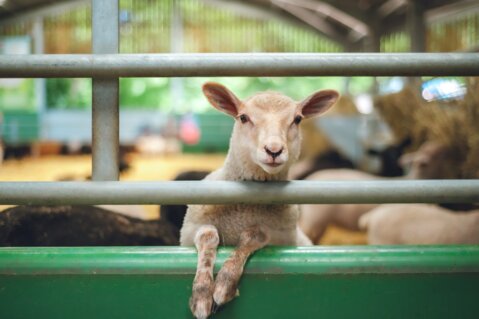Au cours des dernières années, les surfaces laissées en jachère durant l’hiver ont reculé. Cette baisse est due surtout aux engrais verts, mais aussi aux sous-semis, qui sont aussi de plus en plus utilisés dans l’agriculture moderne. Et ce, pour de bonnes raisons : ces couverts végétaux ont de nombreux avantages pour le sol, la rotation des cultures et l’exploitation. En premier lieu, le sol reste efficacement couvert et bien colonisé par les racines, même après la récolte, favorisant la formation d’humus et contribuant à prévenir l’érosion ainsi que la perte de sol qui en découle. En deuxième lieu, cette pratique réduit efficacement la pression des adventices, limite la battance et maintient le sol ombragé, freinant son réchauffement et préservant l’activité des organismes vivants. De plus, la colonisation du sol par les racines exerce un effet stabilisant tout en l’ameublissant, ce qui favorise aussi l’activité biologique. Enfin, les plantes en croissance absorbent les nutriments, empêchant ainsi leur lessivage vers les nappes phréatiques et les restituent lors de leur décomposition au profit de la culture suivante. Il est à noter que les légumineuses ont en outre la capacité, grâce aux bactéries des nodosités présentes sur leurs racines, de fixer l’azote de l’air.
Réguler le régime hydrique
Les engrais verts et les sous-semis contribuent aussi à réguler le régime hydrique des sols : un sol couvert peut absorber davantage d’eau de pluie, présentant une capacité de rétention d’eau supérieure. Ainsi, selon une étude menée en Allemagne, la mise en place d’un engrais vert gélif a permis d’augmenter de 11 % les réserves en eau du sol au moment du semis du maïs, comparativement à une parcelle laissée en jachère. Ce résultat s’explique notamment par le fait que les plantes de couverture entraînent une évaporation de l’eau moindre que celle observée sur un sol nu. Dans le cas des engrais verts non gélifs, il faut noter que ceux-ci prélèvent aussi de l’eau du sol en hiver, et surtout au moment de la reprise de croissance au printemps. Dans les régions sèches, cette caractéristique des engrais de ce type peut générer un déficit hydrique pour la culture suivante. En revanche, dans les zones humides, elle peut être exploitée de manière ciblée pour accélérer le ressuyage des sols au printemps. Lorsque la teneur en humus du sol est accrue en recourant aux engrais verts et aux sous-semis, on observe à long terme un effet positif sur la capacité de rétention d’eau, la fixation du carbone et la résilience du sol.
Choisir le bon mélange
Pour trouver un mélange adapté d’engrais vert ou de sous-semis, le catalogue de semences fourragères de Semences UFA peut fournir une aide précieuse. L’un des critères cruciaux dans ce choix est la culture successive prévue et la rotation culturale : il faut le plus possible éviter que les pauses entre les cultures soient faites avec des plantes de couverture de la même famille botanique que la culture principale. De plus, il faut tenir compte tant des maladies telles que la hernie du chou, la sclérotiniose ou le pié-tin-échaudage, que des problèmes de fatigue du sol affectant les légumineuses, des repousses indésirables ou de la présence de nématodes. Les autres critères importants sont les suivants : date de semis, vitesse de développement juvénile, durée de présence au champ, possibilité d’utiliser en alimentation animale, sensibilité au gel en hiver ou capacité des légumineuses à fixer l’azote.
La colonisation du sol par les racines favorise l’activité biologique.
Réussir les sous-semis
Selon la culture, le site et les conditions météo, le moment du semis et les chances de succès des sous-semis peuvent varier. Pour le colza, le sous-semis – généralement gélif – doit être semé peu avant ou en même temps que la culture principale, au plus tard le 25 août. S’agissant des céréales, du tournesol ou du maïs, le sous-semis est recommandé lors du dernier passage de herse-étrille ou de sarcleuse. Il faut alors trouver un bon compromis sur le moment du semis : semer tôt permet une meilleure installation des plantes, car elles profitent de plus de lumière (moins d’ombre par la culture principale) ; semer plus tard limite la compétition avec la culture principale. La possibilité de réaliser les semis par drone permet désormais de mettre en place des engrais verts deux à six semaines avant la récolte, comme sous-semis dans des céréales en cours de maturation. Quand la météo est favorable, cette modalité de semis (sans travail du sol) favorise la croissance. En revanche, en période de sécheresse, cette méthode augmente le risque de perte, car le sol non travaillé retient moins bien l’humidité nécessaire à la germination.